
Droit des rémunérations et de la protection sociale
Cabinet d’avocats de référence
en droit des rémunérations
et de la protection sociale


Compétences & services
astella avocats est un cabinet de niche dédié aux employeurs ainsi qu’aux professionnels de la rémunération et de la protection sociale (tels que les organismes assureurs ou les courtiers et conseils).
Équipe pointue et passionnée, nous avons à cœur de simplifier des sujets de plus en plus techniques, de toujours trouver une solution pragmatique, et d’aller au-delà de vos attentes habituelles.
C’est pourquoi notre accompagnement ne se limite jamais à « dire le droit » : nos solutions sont en phase avec vos contraintes opérationnelles, fondées sur des arbitrages de risque, synthétiques et accessibles sur le fond comme sur la forme (legal design).
Ces méthodes de travail nous permettent d’atteindre une haute qualité de service et de proposer une forte valeur ajoutée que ce soit en conseil, en formation ou en contentieux.
Conscients que vous devez pouvoir budgéter et maîtriser vos coûts, nous proposons plusieurs modalités tarifaires selon la nature de nos interventions : le forfait (prix fixe), la facturation au temps passé (le cas échéant, avec prix plafonné), l’abonnement (achat d’un volume de prestations à un tarif préférentiel) ou encore l’honoraire de résultats.
Actionnariat salarié
Avantages en nature et en espèces
Partage de la valeur
et épargne salariale
Frais professionnels
Indemnités de départ
Retraite et
fin de carrière
Paie et
charges sociales
Frais de santé, prévoyance et assurance de personnes
Rapports
avec les URSSAF
Rémunération
des dirigeants
Rémunérations variables
et réglementées
Mobilité internationale
Sécurité sociale

Découvrez des exemples concrets de notre accompagnement en sélectionnant un champ de compétence dans la constellation.
Directement tirés de notre expérience quotidienne, faites défiler aléatoirement des problématiques auxquelles nous avons répondu ou des services que nous avons fournis.
Actionnariat salarié
Il s’agit de mécanismes facultatifs permettant à tout ou partie des salariés et dirigeants de devenir actionnaires de l’entreprise. Les formes très différentes qu’ils peuvent prendre ont des incidences considérables sur leur coût pour l’employeur, le traitement social et fiscal pour les parties, ou encore sur le capital et la gouvernance. Nous vous accompagnons dans le choix de ces dispositifs, dans leur mise en place et dans leur mise en œuvre sécurisée vis-à-vis des bénéficiaires, des URSSAF et de l’administration fiscale.
Comment déclarer les gains issus d’actions attribuées gratuitement (AGA) ? De stock options (SO) ? De bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) ?
Les avantages liés à l’actionnariat salarié sont-ils pris en compte pour le calcul des diverses indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail ?
Quels sont les impacts en matière de gouvernance et de dilution du capital d’attributions d’actions (AGA) ou de stock options (SO) ? D’augmentations de capital (AK) ou les cessions de titres (ESPP) réservées aux salariés ?
Nous vous accompagnons dans le cadre de la mise en place, de la gestion ou de la transformation de vos fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) d’actionnariat salarié.
Quelles alternatives à l’actionnariat salarié permettent de préserver la gouvernance et le capital de la société (plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE), contrat de partage de plus-value de cession (CPPVC), phantom shares, etc.) ?
Nous vous accompagnons dans le cadre de la gouvernance de vos fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) d’actionnariat salarié (rôle du conseil de surveillance, élection des représentants des porteurs de parts, modification du règlement, etc.).
Dans quels cas dois-je informer ou consulter le comité social et économique (CSE) en matière d’actionnariat salarié ? Quels sont les risques y afférents ?
Dans quelles conditions les salariés d’une société sœur ou filiale peuvent-ils devenir actionnaires d’une société sœur ou mère ?
Quel est le traitement social et fiscal d’actions attribuées gratuitement (AGA) à des salariés exerçant leur activité à l’étranger ?
Quel est le rôle du plan d’épargne d’entreprise (PEE) dans les dispositifs d’actionnariat salarié ?
Quelles sont les passerelles entre attribution d’actions (AGA) ou de stock options (SO) et plan d’épargne d’entreprise (PEE) ? Quels en sont les avantages fiscaux ?
En quoi certains management packages sont-ils plus risqués que d’autres ?
Comment fonctionnent les augmentations de capital (AK) ou les cessions de titres (ESPP) réservées aux salariés de l’entreprise ?
Quelles contraintes supplémentaires doivent être respectées en cas d’attribution d’avantages d’actionnariat salarié aux dirigeants ?
Comment utiliser les conditions de présence et de performance pour encadrer le bénéfice des dispositifs d’actionnariat salarié ?
Nous défendons votre entreprise à l’égard des URSSAF en matière de plan d’attributions d’actions (AGA) : remboursement de contributions patronales indues, preuve de la conformité d’un plan étranger avec le cadre juridique français, aménagement des sanctions pour violation des obligations déclaratives, etc.
Les avantages liés à l’actionnariat salarié sont-ils pris en compte pour le calcul des budgets du comité économique et social (CSE) ?
L’entreprise peut-elle définir librement les bénéficiaires d’attributions d’actions (AGA) ou de stock options (SO) ? D’augmentations de capital (AK) ou de cessions de titres (ESPP) réservées aux salariés ?
Comment traiter en paie française les avantages d’actionnariat salariés issus de plans étrangers (restricted stock unit (RSU), employee stock purchase plan (ESPP), etc.) ? Qu’est-ce qu’un gross-up (rebrutalisation) ? Un sell to cover ?
Quelles sont les obligations déclaratives en matière d’attribution d’actions (AGA) ? De stock options (SO) ? De bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) ?
Nous rédigeons ou améliorons les actes de mise en place de vos dispositifs (plans et règlements, etc.). Notre expérience nous permet de fournir des actes totalement sécurisés (notamment au regard de vos engagements financiers et des conditions d’exonération) et évolutifs (anticipant les difficultés pouvant survenir et limitant les besoins de modifications ultérieures). Nous apportons également un soin particulier à la lisibilité et la clarté de ces actes (legal design).
Pourquoi l’attribution de stock options (SO) est-elle considérée comme peu avantageuse d’un point de vue de son traitement social et fiscal ?
Quelles peuvent être les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant privé le salarié du bénéfice de dispositifs d’actionnariat salarié ?
Savez-vous que les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) sont une forme de stock options (SO) pouvant être attribuée dans des conditions sociales et fiscales bien plus avantageuses, et concernent en réalité de nombreuses entreprises et l’ensemble de leurs salariés ?
Comment utiliser le mécanisme du fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) de reprise ou de rachat pour compléter un management package ?
Nous formons vos équipes paie et ressources humaines afin qu’elles puissent répondre aux questions de vos collaborateurs et leur expliquer ces dispositifs, mais aussi adopter les bonnes pratiques (sécurisantes vis-à-vis des salariés et des URSSAF).
Comment fonctionnent les abondements en actions de l’entreprise au plan d’épargne entreprise (PEE), bénéficiant d’un taux de forfait social préférentiel à 10 % ?
Comment choisir entre la détention d’actions « en direct » ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) d’actionnariat salarié ?
Nous vous accompagnons dans le cadre de l’élection, au conseil d’administration de votre société, des administrateurs représentant les salariés actionnaires (ARSA).
Quels mécanismes d’actionnariat salarié coûtent davantage à l’entreprise qu’aux bénéficiaires ? Et inversement ? Lesquels garantissent un gain aux bénéficiaires ou lui font prendre un risque financier ?
Nous adaptons les plans étrangers d’attribution d’actions (AGA) au cadre juridique français.
Dans les sociétés non-cotées, comment encadrer la liquidité des actions, leurs modalités de valorisation, organiser la stabilité de l’actionnariat ou encore la transmission de l’entreprise (pactes d’actionnaires, etc.) ?
Avantages en nature et en espèces
Véhicules de fonction, réductions tarifaires, titres restaurant, frais de transport, maintien de salaire, compte épargne temps (CET)… : la liste des avantages divers dont peut bénéficier le personnel d’une entreprise est pratiquement illimitée. Nous vous aidons à sécuriser vos pratiques en la matière, vis-à-vis des URSSAF et de vos salariés.
Quels sont les avantages devant être institués par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur ?
Nous rédigeons ou revoyons vos accords collectifs instituant un compte épargne temps (CET).
En quoi consiste l’obligation patronale de maintien de salaire ? Comment déterminer celle applicable à l’entreprise ? Quelle est son articulation avec les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et les indemnités journalières complémentaires de prévoyance (IJC) ? Peut-elle être couverte par un contrat d’assurance et avec quelles précautions ?
Quelles sont les règles encadrant l’attribution de tickets restaurant et conditionnant l’exonération de charges sociales et d’impôt sur le revenu du financement patronal ?
Quelles sont les précautions à prendre pour que les séminaires d’entreprise ne soient pas qualifiés d’avantage en nature par une URSSAF ?
Le financement par l’employeur de crèches d’entreprises ou de réservations de berceaux peut-il être exonéré de charges sociales ?
Dans quelles conditions les avantages attribués par le comité social et économique (CSE) peuvent-ils être exonérés de charges sociales et d’impôt sur le revenu ? Quelles sont les points d’attention à anticiper en vue d’un contrôle de l’URSSAF ?
Comment évaluer correctement l’avantage en nature « véhicule » (mise à disposition de véhicules aux salariés, achetés ou loués, avec ou sans prise en charge du carburant, etc.) ? Quels sont les éléments à conserver en vue d’un contrôle de l’URSSAF ?
Quel est le traitement en paie des indemnités de non-concurrence ?
Dans quelles conditions puis-je offrir à mes salariés des réductions sur les produits de l’entreprise en franchise de charges sociales ? Et sur les produits invendus ? Quels sont les points d’attention à anticiper en vue d’un contrôle de l’URSSAF ?
À la suite du transfert des salariés d’une entreprise à une autre (par exemple en cas de fusion-absorption), les avantages en nature continuent-ils à s’appliquer aux salariés transférés ? Selon quelles modalités et pour quelle durée ?
Quel est le traitement en paie de prêts sans intérêt (dits prêts « gratuits » ou « à taux réduits ») octroyés aux salariés ? Quelles précautions doivent être prises ?
Nous formons vos équipes paie et ressources humaines afin qu’elles puissent répondre aux questions de vos collaborateurs et leur expliquer ces dispositifs, mais aussi adopter les bonnes pratiques (sécurisantes vis-à-vis des salariés et des URSSAF).
Comment une entreprise peut-elle récupérer une prime d’arrivée (welcome bonus) versée à un salarié ayant quitté l’entreprise avant une certaine date ?
Quel est le sort du compte épargne-temps (CET) en cas de transfert des salariés d’une entreprise à une autre (par exemple en cas de fusion-absorption) ?
Dans quelles conditions une prime versée à l’occasion de la remise de la médaille du travail peut-elle être exonérée de charges sociales ?
Nous rédigeons ou améliorons les actes de mise en place de vos dispositifs (accords collectifs, décisions unilatérales, règlements, etc.). Notre expérience nous permet de fournir des actes totalement sécurisés (notamment au regard de vos engagements financiers et des conditions d’exonération) et évolutifs (anticipant les difficultés pouvant survenir et limitant les besoins de modifications ultérieures). Nous apportons également un soin particulier à la lisibilité et la clarté de ces actes (legal design).
Quels sont les différents dispositifs permettant de prendre en charge en tout ou partie les frais de transport des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail (forfait mobilités durables, prime de carburant, prise en charge des abonnements aux transports en commun, etc.) ? Quelles sont les points d’attention à anticiper en vue d’un contrôle de l’URSSAF ?
Quel est le traitement en paie d’une indemnité d’occupation du domicile ?
Quelles sont les règles encadrant le financement patronal des restaurants d’entreprise et conditionnant son exonération de charges sociales et d’impôt sur le revenu ? Quels sont les points d’attention à anticiper en vue d’un contrôle de l’URSSAF ?
En quoi consiste la création d’un « groupe fermé » de salariés bénéficiaires d’un avantage social à la suite d’un transfert de salariés ?
Un salarié peut-il voire doit-il bénéficier des mêmes avantages en nature au titre des jours pendant lesquels il est en télétravail ?
Comment l’entreprise peut-elle financer les activités sportives des salariés en franchise de charges sociales ?
Partage de la valeur
et épargne salariale
Il s’agit de dispositifs obligatoires ou facultatifs, procurant aux salariés et dirigeants des rémunérations immédiates ou différées, variant souvent selon les résultats ou les performances de l’entreprise, et permettant généralement de constituer une épargne. Nous vous accompagnons dans le choix de ces mécanismes, dans leur mise en place et dans leur mise en œuvre sécurisée vis-à-vis des salariés et des URSSAF.
Nous proposons aux professionnels de l’épargne salariale une veille novatrice et ergonomique des textes conventionnels en matière de participation, intéressement et plans d’épargne, en amont de leur publication sur Légifrance. Elle permet de rester informé le plus rapidement possible, dans chaque branche, de la signature de nouveaux textes, de leur extension et de leur agrément.
Quelles sont les synergies entre la participation, l’intéressement et la prime de partage de la valeur (PPV) d’une part, et les plans d’épargne (plans d’épargne d’entreprise (PEE) et plans d’épargne retraite (PER) collectifs) d’autre part ?
En matière d’offre financière proposée dans le cadre d’un plan d’épargne (plan d’épargne d’entreprise (PEE) et plan d’épargne retraite (PER) collectif), que sont les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) ?
En quoi consiste les accords de groupe de participation ou d’intéressement ? Comment les conclure ? Quelles en sont les clauses spécifiques ?
Dans le cadre d’un plan d’épargne (plan d’épargne d’entreprise (PEE) et plan d’épargne retraite (PER) collectif), dans quelles conditions l’entreprise ou le teneur de compte peuvent-ils changer les modalités d’investissement de l’épargne des salariés ?
Quelles sont les différentes formules d’abondement possibles sur les plans d’épargne d’entreprise (PEE) et plans d’épargne retraite (PER) collectifs ?
En quoi consiste l’abondement unilatéral, à l’ouverture du plan ou périodiquement, sur les plans d’épargne retraite (PER) collectifs ?
En quoi consiste l’obligation de prise en charge des frais de tenue de compte sur les plans d’épargne d’entreprise (PEE) et plans d’épargne retraite (PER) collectifs ? Quels autres frais sont applicables ?
Comment compléter un dispositif d’intéressement par un intéressement de projet spécifique à certains salariés ?
Nous validons vos modalités de répartition de la participation ou de l’intéressement entre les salariés.
Les dispositifs de partage de la valeur doivent-ils bénéficier aux salariés intérimaires travaillant pour l’entreprise ?
Au sein d’un dispositif d’intéressement, comment faire varier les modalités de calcul et de versement entre les différents établissements ou unités de travail de l’entreprise ?
À l’instar de l’intéressement, existe-t-il des dates limites de mise en place pour la participation ou pour les plans d’épargne (plan d’épargne d’entreprise (PEE) et plan d’épargne retraite (PER) collectif ?
À partir de quand suis-je dans l’obligation de verser de la participation à mes salariés ?
Quel est le traitement social et fiscal de la participation ou de l’intéressement versés à des salariés travaillant à l’étranger ?
À la suite du transfert des salariés d’une entreprise à une autre (par exemple en cas de scission), les dispositifs de partage de la valeur continuent-ils à s’appliquer aux salariés transférés ? Selon quelles modalités et pour quelle durée ?
En quoi consiste l’examen des accords et décisions unilatérales à la suite de leur dépôt obligatoire ? En quoi peut-il grandement sécuriser les exonérations sociales et fiscales applicables aux sommes versées et comment l’exploiter ?
Nous rédigeons ou améliorons les différents documents contractuels de la relation entre entreprise et teneur de compte (convention de tenue de compte, etc.). Notre expérience nous permet de fournir des actes totalement sécurisés pour les parties et évolutifs (anticipant les difficultés pouvant survenir et limitant les besoins de modifications ultérieures). Nous apportons également un soin particulier à la lisibilité et la clarté de ces actes (legal design).
Quelles sont les passerelles entre attribution d’actions (AGA) ou de stock options (SO) et plan d’épargne d’entreprise (PEE) ? Quels en sont les avantages fiscaux ?
Comment les branches professionnelles peuvent-elles mettre en place des dispositifs d’épargne salariale « clef en main » ?
Les décisions unilatérales instituant des plans d’épargne salariale (plans d’épargne d’entreprise (PEE) et plans d’épargne retraite (PER) collectifs) doivent-elles être remises aux salariés ? Selon quelles modalités ?
Quelles sont les conditions à remplir pour que les dirigeants sans contrat de travail puissent bénéficier des dispositifs de partage de la valeur ?
Comment procéder au dépôt obligatoire des accords et décisions unilatérales instituant les dispositifs de partage de la valeur ? Sous quels délais ? Avec quelles pièces obligatoires ?
Comment choisir entre une prime de partage de la valeur (PPV) et un supplément de participation ou d’intéressement ?
Lors de la préparation d’accords, avenants ou décisions unilatérales, nous préparons pour vous les documents nécessaires à la signature (procès-verbaux, listes d’émargement, documents justificatifs à déposer, etc.).
Comment fonctionnent les abondements en actions de l’entreprise au plan d’épargne entreprise (PEE), bénéficiant d’un taux de forfait social préférentiel à 10 % ?
Selon quels critères la prime de partage de la valeur (PPV) peut-elle être réservée à certains salariés de l’entreprise ?
En quoi les transferts de salariés peuvent-ils avoir une incidence favorable ou défavorable sur les modalités de calcul des effectifs de l’entreprise et donc sur l’obligation de mettre en place de la participation ou sur les exonérations de forfait social ?
Y a-t-il des règles à respecter pour modifier des modalités d’abondement au sein d’un plan d’épargne (plan d’épargne d’entreprise (PEE) et plan d’épargne retraite (PER) collectif) mis en place unilatéralement ?
Comment choisir entre les différents modes de mise en place possibles pour les accords de partage de la valeur (accord avec les délégués syndicaux, le comité social et économique (CSE) ou ratifié par les salariés) ? Quelles en sont les modalités concrètes ?
Après le 1er janvier 2024, dans quelles conditions la prime de partage de la valeur (PPV) peut-elle encore être exonérée de toute charge sociale et d’impôt sur le revenu ?
Quelles rédactions d’accords ou de règlements unilatéraux permettent de faire évoluer facilement les dispositifs sans modification systématique de l’acte de mise en place ?
Nous rédigeons ou améliorons les actes de mise en place de vos dispositifs (accords ou règlements). Notre expérience nous permet de fournir des actes totalement sécurisés (notamment au regard de vos engagements financiers et des conditions d’exonération) et évolutifs (anticipant les difficultés pouvant survenir et limitant les besoins de modifications ultérieures). Nous apportons également un soin particulier à la lisibilité et la clarté de ces actes (legal design).
Quand et comment tirer les conséquences en matière de participation ou d’intéressement d’une rectification fiscale des résultats de l’entreprise ?
En cas de transferts de salariés, qu’advient-il des contrats passés par leur précédente entreprise avec ses prestataires d’épargne salariale (teneurs de compte, etc.) ?
Quels sont les avantages fiscaux attachés aux plus-values et dividendes réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne (plan d’épargne d’entreprise (PEE) et plan d’épargne retraite (PER) collectif) ?
Existe-t-il des documents devant être impérativement remis par l’employeur à ses salariés concernant les plans d’épargne (plans d’épargne d’entreprise (PEE) et plans d’épargne retraite (PER) collectifs) ?
En quoi est-il indispensable de maîtriser les modalités de calcul des effectifs de l’entreprise (obligation ou non de verser de la participation, exonérations de forfait social, etc.) ?
Comment gérer les erreurs dans la répartition de la participation ou de l’intéressement entre les salariés ? Ou les erreurs de calcul de l’enveloppe globale ?
Quelles sont les conséquences de la rupture du contrat de travail pour les bénéficiaires de dispositifs de partage de la valeur ?
Quelles sont les contraintes propres aux formules de participation dérogatoires à la formule légale ?
Quelles solutions permettent d’instituer, après le 30 juin, un dispositif d’intéressement applicable immédiatement ?
Comment instituer un dispositif d’intéressement dont les critères de calcul ou objectifs seront revus chaque année ?
Quelles sont les particularités de la mise en place de la participation au sein d’une unité économique et sociale (UES) ?
Nous formons vos équipes paie et ressources humaines afin qu’elles puissent répondre aux questions de vos collaborateurs et leur expliquer ces dispositifs, mais aussi adopter les bonnes pratiques (sécurisantes vis-à-vis des salariés et des URSSAF).
Quel est le rôle du plan d’épargne d’entreprise (PEE) dans les dispositifs d’actionnariat salarié ?
En quoi les suppléments de participation ou d’intéressement sont-ils extrêmement utiles ?
Dans quelles conditions les dispositifs de partage de la valeur peuvent-ils être mis en place unilatéralement ?
À partir du 1er janvier 2025, en quoi consistera l’obligation pour les entreprises de moins de 50 salariés réalisant un certain bénéfice de mettre en place un dispositif de partage de la valeur ? Quels sont les risques pouvant être encourus ?
Quelles sont les modalités de prescription de l’action des salariés en paiement de la participation, de l’intéressement ou de l’abondement ?
Dans quels cas dois-je informer ou consulter le comité social et économique (CSE) en matière de partage de la valeur ? Quels sont les risques y afférents ?
En quoi consiste l’obligation d’ouvrir, avant le 30 juin 2024, une négociation sur les conséquences en matière de partage de la valeur d’une augmentation exceptionnelle des bénéfices ? Quel sont les risques pouvant être encourus ?
Nous rédigeons des notes et guides destinés aux salariés expliquant de façon pédagogique le fonctionnement des différents dispositifs de partage de la valeur en vigueur dans votre entreprise.
Nous vous aidons à définir vos critères et modalités de calcul de l’intéressement et à les retranscrire dans votre accord ou décision unilatérale.
Comment maîtriser l’engagement financier de l’entreprise dans le cadre de l’intéressement (paliers, plafonds, plafonnement global de la participation et de l’intéressement, utilisation des suppléments, etc.) ?
Quels sont les critères de performance extra-financière et/ou liés à la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) pouvant être utilisés dans un dispositif d’intéressement ?
Comment utiliser à bon escient les clauses de tacite reconduction en matière d’intéressement ou d’abondement ?
Quelles sont les conséquences de la suspension du contrat de travail (arrêt de travail, congé sans solde, congé de reclassement ou de mobilité, etc.) pour les bénéficiaires de dispositifs de partage de la valeur ?
En matière de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et de fonds communs de placement d’entreprise (FCPE), les prestations de gestion sont-elles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ? Et leur commercialisation ?
Les salariés travaillant à l’étranger doivent-ils bénéficier des dispositifs de partage de la valeur ? Selon quelles modalités ?
Quelles sont les conséquences d’une fusion-absorption rétroactive sur les dispositifs de participation et d’intéressement ?
Qu’est-ce qu’un plan d’épargne retraite (PER) unique ?
Quels documents le teneur de compte mettant en œuvre un plan d’épargne (plan d’épargne d’entreprise (PEE) et plan d’épargne retraite (PER) collectif) peut-il exiger des salariés souhaitant réaliser un déblocage anticipé de leur épargne ?
Frais professionnels
Ce sont des sommes versées par l’employeur destinées à rembourser des dépenses du salarié dans le cadre de son activité professionnelle et qui ne sont pas soumises à charges sociales (indemnités kilométriques (IK), repas lors de déplacements professionnels ou d’affaires, frais de télétravail, mobilité professionnelle, etc.). Leur versement doit impérativement être encadré afin d’éviter tout litige avec les URSSAF ou avec les salariés. Nous vous accompagnons entièrement sur ce sujet.
Afin de vous accompagner dans la mise en place de process sécurisants en matière de remboursement de frais professionnels, nous préparons pour vous des notes internes et des formulaires ergonomiques destinés aux salariés.
Dans quelles conditions l’entreprise peut-elle rembourser forfaitairement les frais de repas et/ou de logement des salariés en déplacement sur plusieurs jours (indemnités de grand déplacement) en franchise de charges sociales ? Quelles sont les pièces à conserver en vue d’un contrôle de l’URSSAF ?
Dans quelles conditions l’entreprise peut-elle rembourser des frais de déménagement (frais de mobilité) à ses salariés sans qu’ils ne soient soumis à charges sociales ? Quelles sont les conditions à démontrer en cas de contrôle de l’URSSAF ?
Quels justificatifs faut-il conserver pour que le remboursement des repas d’affaire ne puisse pas être soumis à charges sociales par une URSSAF ?
Comment verser des indemnités kilométriques (IK) forfaitaires aux salariés en exonération de charges sociales et d’impôt sur le revenu ? Quels sont les éléments à conserver en vue d’un contrôle de l’URSSAF ?
Nous formons vos équipes paie et ressources humaines afin qu’elles puissent répondre aux questions de vos collaborateurs et leur expliquer ces dispositifs, mais aussi adopter les bonnes pratiques (sécurisantes vis-à-vis des salariés et des URSSAF).
Dans quelles conditions l’employeur peut-il rembourser forfaitairement les frais de repas des salariés contraints de prendre un repas spécifique sur leur lieu de travail (primes de panier ou de casse-croûte) en franchise de charges sociales ? Quels sont les éléments à conserver en vue d’un contrôle de l’URSSAF ?
Nous vous accompagnons dans la mise en place de process garantissant que vos remboursements de frais professionnels ne seront pas soumis à charges sociales en cas de contrôle d’une URSSAF.
Dans quelles conditions l’employeur peut-il rembourser forfaitairement les frais de repas des salariés en déplacement à l’heure du déjeuner (indemnités de petit déplacement) en franchise de charges sociales ? Quels sont les éléments à conserver en vue d’un contrôle de l’URSSAF ?
Quelles sont les précautions à prendre pour que les séminaires d’entreprise ne soient pas qualifiés d’avantage en nature par une URSSAF ?
Dans quelles conditions l’entreprise peut-elle rembourser forfaitairement des frais de télétravail en franchise de charges sociales ? Quelles sont les conditions à démontrer en cas de contrôle de l’URSSAF ?
Indemnités de départ
La rupture du contrat de travail peut donner lieu à une multitude d’indemnités (de licenciement, de congé de reclassement ou de mobilité, de formation, etc.) et s’inscrire dans des cadres juridiques très variés (plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou de départ volontaire (PDV), rupture conventionnelle collective (RCC), etc.), que ce soit pendant la carrière ou lors du départ à la retraite. Leurs modalités de calcul et leur traitement en paie peuvent s’avérer complexes et méritent un accompagnement.
Peut-on verser une indemnité de départ à un mandataire social révoqué ? Si oui, selon quelles modalités ?
Le traitement social spécifique de l’indemnité de congé de reclassement s’applique-t-il au-delà du montant minimum imposé par la loi ?
En matière de charges sociales, comment déterminer les taux et plafonds d’assiette applicables aux indemnités de rupture du contrat de travail ? Et aux sommes versées en exécution d’une décision de justice ?
Nous formons vos équipes paie et ressources humaines afin qu’elles puissent répondre aux questions de vos collaborateurs et leur expliquer ces dispositifs, mais aussi adopter les bonnes pratiques (sécurisantes vis-à-vis des salariés et des URSSAF).
Toutes les sommes versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) sont-elles susceptibles d’être exonérées d’impôt et de charges ? Sous quelles conditions et limites ?
Les avantages liés à l’actionnariat salarié sont-ils pris en compte pour le calcul des diverses indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail ?
Peut-on verser par anticipation, pendant le congé de fin de carrière d’un salarié, une partie de son indemnité de rupture du contrat de travail de manière fractionnée sans en modifier la qualification sociale et fiscale ?
Comment neutraliser les incidences du congé de reclassement ou de mobilité en matière de retraite de base ou de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ?
Dans quelles conditions les mandataires sociaux sans contrat de travail peuvent-ils bénéficier des dispositifs de partage de la valeur (condition d’effectif, spécificités, autorisations de l’organe social compétent, etc.) ?
Quel est le traitement en paie des indemnités de non-concurrence ?
Quel est le traitement social et fiscal applicable aux indemnités transactionnelles ? Comment différencier les sommes de nature salariale ou indemnitaire (dommages-intérêts) ?
Pendant un congé de reclassement ou de mobilité, quels sont les avantages sociaux (retraite, frais de santé, prévoyance, etc.) pouvant être maintenus aux salariés et selon quelles modalités ?
Quelles sommes peuvent-elles être qualifiées d’indemnitaires ou de dommages-intérêts et ainsi ne pas être soumises à charges sociales et à impôt sur le revenu ?
Les salariés en congé de reclassement ou de mobilité bénéficient-ils de la participation et de l’intéressement ? Selon quelles modalités ?
Comment traiter en paie des sommes versées de façon échelonnée sur plusieurs échéances après la rupture du contrat de travail ?
Au sein d’une branche professionnelle, puis-je être contraint de financer un fonds destiné à payer les indemnités de fin de carrière (IFC) des salariés ?
Quelles peuvent être les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant privé le salarié du bénéfice de dispositifs d’actionnariat salarié ?
Quel est le traitement fiscal (taxe sur les contrats d’assurance (TSCA), taxe sur la valeur ajoutée (TVA), impôt sur les sociétés (IS)) du financement d’un contrat « indemnités de fin de carrière (IFC) » ?
Retraite et
fin de carrière
Chaque composante du système de retraite relève d’un environnement juridique différent, tel que le régime de base de la sécurité sociale et le régime complémentaire (AGIRC-ARRCO pour les salariés du privé). La retraite supplémentaire peut quant à elle prendre la forme de dispositifs d’épargne variés, à cotisations ou à prestations définies, faisant intervenir des organismes assureurs (assurance-vie) ou des teneurs de compte. Les entreprises disposent également d’outils pour préparer au mieux la fin de carrière de leurs salariés (préretraites ou congés de fin de carrière, retraite progressive ou cumul emploi retraite, etc.).
Comment réaliser un « gross-up » (rebrutalisation) du financement d’un contrat d’épargne dit « article 82 » afin de neutraliser ses incidences sur le salaire net des bénéficiaires ?
Dans le cadre de la liquidation de l’épargne en rente de retraite, à quoi correspondent le taux et les tables de mortalité ?
Quel est le traitement fiscal (taxe sur les contrats d’assurance (TSCA), taxe sur la valeur ajoutée (TVA), impôt sur les sociétés (IS)) du financement d’un contrat « indemnités de fin de carrière (IFC) » ?
Lors d’une opération de restructuration entre plusieurs entreprises relevant d’institutions de retraite complémentaire et de conditions d’adhésion différentes, est-il impératif de procéder à une harmonisation ?
Dans quelles situations les entreprises souscrivent-elles des contrats d’épargne dit « article 82 » au profit de leurs salariés ?
Comment fonctionne le mécanisme de retraite progressive ?
Quelles sont les modalités de prescription d’une action d’une caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO contre l’entreprise en paiement des cotisations ?
Un transfert de salariés d’une entreprise à une autre (par exemple en cas de fusion-absorption) peut-il entraîner des conséquences en matière de conditions de cotisation au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ?
Le contrat d’assurance retraite souscrit au profit de mes salariés est-il résiliable, et si oui, dans quelles conditions ?
Quel est le traitement social et fiscal du financement d’un contrat d’épargne dit « article 82 » ?
Les nouveaux produits « L. 137-11-2 » à droits acquis remplacent-ils efficacement les anciens contrats de retraite à prestations définies à droits aléatoires ?
Puis-je transférer à tout moment les sommes épargnées dans d’anciens contrats de retraite vers mon contrat actuel ? Si oui, est-il opportun d’y procéder ou cela comporte-t-il des risques ?
Dans quelles conditions un organisme assureur peut-il verser un capital en lieu et place d’une rentre de retraite supplémentaire ?
Que sont devenus les salariés relevant de l’article 36 de l’annexe I de la CCN « AGIRC » du 14 mars 1947 depuis la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO ?
Est-il obligatoire ou pertinent de transformer les anciens contrats de retraite de type « article 83 » en nouveau plan d’épargne retraite (PER) obligatoire ? Les sommes épargnées seront-elles automatiquement transférées vers les nouveaux produits ?
En matière d’épargne retraite, qu’est-ce qu’une comptabilité auxiliaire d’affectation ou « canton » ?
En cas d’externalisation du passif en matière d’indemnités de fin de carrière (IFC) par la souscription d’un contrat d’assurance, pourrais-je récupérer les fonds en cas de sur-provisionnement lié notamment à une baisse importante des effectifs de l’entreprise ?
Comment neutraliser les incidences du congé de reclassement ou de mobilité en matière de retraite de base ou de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ?
Dans quelles conditions une personne peut-elle cumuler ses pensions de retraite avec le revenu d’une activité professionnelle ?
Le financement d’un contrat d’épargne dit « article 82 » est-il pris en compte pour le calcul des budgets du comité social et économique (CSE) ? Pour les droits à participation et intéressement ? Pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail ?
Quelles sont mes obligations légales et conventionnelles en matière de retraite supplémentaire (catégorie de salariés concernés, niveau de financement, etc.) ?
Comment fonctionnent les différentes passerelles vers les dispositifs d’épargne retraite, et notamment celle du compte épargne-temps (CET) ou des jours de repos non-pris vers les plans d’épargne retraite (PER) collectifs ou obligatoires ?
Quels nouveaux outils permettent de continuer à fidéliser les hauts potentiels depuis la fermeture imposée des anciennes « retraites chapeau » ?
Puis-je conditionner l’accès au régime de retraite supplémentaire à une ancienneté minimale ?
Une cotisation patronale majorée en matière de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO est-elle exonérée de toute charge sociale comme celle de droit commun ?
Quelles sont les incidences du travail à temps partiel sur les droits à retraite ? Comment y remédier ?
Comment modifier ou supprimer le financement par l’employeur d’un régime de frais de santé bénéficiant aux anciens salariés retraités ?
À quelle clause des contrats d’externalisation des indemnités de fin de carrière (IFC) faut-il prêter attention lors de la souscription ?
Quel intérêt pour un assureur de constituer un fonds de retraite professionnel supplémentaire (FRPS) et d’y transférer l’intégralité de son portefeuille de contrats de retraite ?
Reste-t-il des spécificités et des conditions d’application différentes entre les salariés cadres et non cadres depuis la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO ?
Comment modifier ou supprimer un régime de retraite garantissant le versement d’une rente à d’anciens salariés (régimes de retraite à prestations définies ou « retraites chapeau ») ?
Quels sont les avantages et les modalités des rachats de trimestres d’assurance vieillesse ?
Un organisme assureur peut-il résilier un contrat d’assurance d’épargne retraite ?
En matière de plan d’épargne retraite (PER), quel est le traitement social et fiscal du capital versé en lieu et place des rentes de faible montant ?
À la suite du transfert des salariés d’une entreprise à une autre (par exemple en cas de fusion-absorption), les dispositifs d’épargne retraite continuent-ils à s’appliquer aux salariés transférés ? Selon quelles modalités et pour quelle durée ?
Quelles sont les caractéristiques des plans d’épargne retraite (PER) issus de la loi « PACTE » ? Quelles sont leurs différences par rapport aux anciens produits d’épargne retraite ? Est-il avantageux de transformer les anciens dispositifs ?
Quelle condition doit remplir la gestion pilotée propre aux plans d’épargne retraite (PER) ?
Nous rédigeons ou améliorons les actes de mise en place de vos dispositifs (accords, décisions unilatérales ou règlements). Notre expérience nous permet de fournir des actes totalement sécurisés (notamment au regard de vos engagements financiers et des conditions d’exonération) et évolutifs (anticipant les difficultés pouvant survenir et limitant les besoins de modifications ultérieures). Nous apportons également un soin particulier à la lisibilité et la clarté de ces actes (legal design).
Comment le préjudice issu du manque à gagner en matière de retraite, par exemple en raison d’une erreur de cotisation pendant la carrière, peut-il être réparé au moment du départ à la retraite ?
Nous rédigeons ou améliorons les différents documents contractuels de la relation entre entreprise et organisme assureur (contrat d’assurance, notice d’information, etc.). Notre expérience nous permet de fournir des actes totalement sécurisant pour les parties et évolutifs (anticipant les difficultés pouvant survenir et limitant les besoins de modifications ultérieures). Nous apportons également un soin particulier à la lisibilité et la clarté de ces actes (legal design).
Comment traiter en paie l’octroi d’un avantage (réductions tarifaires, etc.) aux anciens salariés retraités ?
Nous vérifions si vos dispositifs de retraite supplémentaire sont conformes aux règles conditionnant les exonérations sociales et fiscales du financement par l’employeur.
Comment sont calculées les pensions de retraite dans les différents régimes de sécurité sociale, de base et complémentaires ?
Nous formons vos équipes paie et ressources humaines afin qu’elles puissent répondre aux questions de vos collaborateurs et leur expliquer ces dispositifs, mais aussi adopter les bonnes pratiques (sécurisantes vis-à-vis des salariés et des URSSAF).
Quelles sont les incidences de la cessation anticipée d’activité, du congé de reclassement ou de mobilité sur les droits à retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ? Comment y remédier ?
Dans quelles conditions mes salariés peuvent-ils transférer leur épargne d’un contrat d’épargne retraite vers un autre ? Puis-je décider de ce transfert à leur place ?
Comment augmenter ou diminuer le financement par l’employeur d’un régime de retraite supplémentaire ?
En quoi consiste la création d’un « groupe fermé » de salariés bénéficiaires d’un régime de retraite supplémentaire à la suite d’un transfert de salariés ?
Qu’est-ce qu’un fonds de retraite professionnel supplémentaire (FRPS) ? Quels sont les avantages et inconvénients de souscrire un contrat d’assurance auprès d‘un FRPS plutôt que d’un assureur vie classique ?
À quoi correspond le statut de salarié dit « article 36 » en matière de retraite supplémentaire ?
Dans quels cas dois-je informer ou consulter le comité social et économique (CSE) en matière de retraite supplémentaire ? Quels sont les risques y afférents ?
Quels sont les avantages et inconvénients réciproques entre un contrat dit « article 82 » et un contrat de retraite à prestations définies relevant de l’article L. 137-11-2 du CSS ?
Quelles sont les conditions de liquidation des pensions de retraite dans les différents régimes de sécurité sociale, de base et complémentaires ?
Quels sont les contours exacts de l’obligation pour un organisme assureur de redistribuer des bénéfices techniques et financiers à ses assurés ?
Comment traiter en paie le financement par l’employeur d’un régime de frais de santé bénéficiant aux anciens salariés retraités ?
Quel est l’intérêt d’externaliser son passif social en matière d’indemnités de fin de carrière (IFC) plutôt que de le provisionner en interne ?
Au sein d’une branche professionnelle, puis-je être contraint de financer un fonds destiné à payer les indemnités de fin de carrière (IFC) des salariés ?
En cas de transferts de salariés, qu’advient-il des contrats passés par leur précédente entreprise avec ses prestataires d’épargne retraite (organismes assureurs, teneurs de compte, etc.) ?
Qu’est-ce que la notice d’information relative au contrat d’assurance de retraite supplémentaire souscrit au profit de mes salariés ? En quoi consiste l’obligation de remise aux salariés et quels sont les risques y afférents ?
Quels sont les droits du conjoint survivant en matière de réversion d’une rente de retraite supplémentaire ? Et ceux d’un éventuel ex-conjoint ?
Comment mettre un terme à une modalité particulière de cotisation au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (opération supplémentaire ou répartition dérogatoire) ?
Nous vous accompagnons dans le choix du produit d’épargne retraite le plus adapté à vos besoins et aux différents profils de vos salariés bénéficiaires.
Paie et
charges sociales
La France occupe la première place de l’Indice mondial de complexité de la paie et les charges sociales y sont parmi les plus élevées du monde. Les innombrables cas particuliers en matière de conditions d’exonération des divers avantages sociaux, de taux et plafonds applicables, d’obligations déclaratives, ou encore de calcul des effectifs, imposent un accompagnement par des experts.
Un transfert de salariés d’une entreprise à une autre (par exemple en cas de fusion-absorption) peut-il entraîner des conséquences en matière de conditions de cotisation au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ?
Quelles sommes peuvent être qualifiées d’indemnitaires ou de dommages-intérêts et ainsi ne pas être soumises à charges sociales et à impôt sur le revenu ?
Quelles sont les sommes soumises au forfait social et quels sont les différents taux applicables ?
Quel est le traitement en paie des indemnités journalières complémentaires (IJC) de prévoyance ? En quoi consiste la « règle du prorata » ?
Y a-t-il un délai de rectification maximal des erreurs de paie, notamment pour y procéder via la déclaration sociale nominative (DSN) ?
Quelles sont les obligations déclaratives en matière d’attribution d’actions (AGA) ? De stock options (SO) ? De bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) ?
Quelles sont les modalités d’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) ?
Comment traiter en paie les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne perçoivent, pendant cette période, que des avantages en nature ?
La réduction générale des cotisations patronales (parfois appelée réduction « Fillon ») est particulièrement complexe à calculer et à mettre en œuvre. Nous vous accompagnons dans la sécurisation de chacun de ses paramètres de calcul.
En quoi les transferts de salariés peuvent-ils avoir une incidence favorable ou défavorable sur les modalités de calcul des effectifs de l’entreprise ?
Quel est le traitement en paie de l’utilisation des droits épargnés sur le compte épargne temps (CET) ? Et en cas d’affectation à un plan d’épargne retraite (PER) ?
Quel est le traitement en paie des « jetons de présence » rémunérant les administrateurs de sociétés ?
Quel est le traitement en paie des indemnités de non-concurrence ?
Comment les transferts de salariés s’articulent-ils avec certaines règles de paie telle que la régularisation des assiettes plafonnées ?
Y a-t-il des différences de charges sociales applicables entre la rémunération d’un salarié et celle d’un mandataire social « assimilé salarié » ?
Comment estimer les incidences financières d’un redressement de charges sociales par l’URSSAF à la suite d’un contrôle ?
Les sommes versées aux salariés travaillant à l’étranger sont-elles soumises à CSG/CRDS ? Et au forfait social ?
Comment procéder lorsque, par erreur, des charges salariales n’ont pas été précomptées sur la rémunération des salariés ? Comment les récupérer ?
Comment obtenir le remboursement de charges sociales indument versées aux URSSAF ? Le cas échéant, comment restituer les charges salariales aux salariés et comment traiter ce remboursement en paie ?
Nous formons vos équipes paie et ressources humaines afin qu’elles puissent répondre aux questions de vos collaborateurs et leur expliquer ces sujets, mais aussi adopter les bonnes pratiques (sécurisantes vis-à-vis des salariés et des URSSAF).
Les rémunérations versées à des tiers n’étant pas salariés de l’entreprise sont-elles soumises à charges sociales ? Selon quelles modalités ?
Quel est le traitement en paie d’une indemnité d’occupation du domicile ?
Quelles sont les différentes règles applicables à la proratisation des assiettes plafonnées de certaines charges sociales ? En quoi consiste la régularisation de ces assiettes ?
Est-il possible de se fonder sur une publication de l’URSSAF, sur une circulaire ministérielle ou sur le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) pour valider une pratique de paie ? À l’inverse, est-il obligatoire de la respecter ?
Les rectifications spontanées de charges sociales par les entreprises sont-elles possibles, y compris lorsqu’il s’agit de récupérer un remboursement de charges sociales trop versées ?
Comment sécuriser le recours à des travailleurs indépendants sans s’exposer au risque de travail dissimulé ?
Quelles sont les particularités en paie des rémunérations versées aux salariés ayant plusieurs employeurs ?
Quel est le traitement en paie des avantages octroyés par l’entreprise à des personnes tierces ?
Peut-on voire doit-on faire une paie pour les avantages versés à d’anciens salariés retraités ?
Lorsque vous rencontrez des situations techniques et atypiques, nous validons dans le détail les paies concernées.
Quand et comment pratiquer une rebrutalisation (« gross up« ) sur un élément de rémunération ?
Un de mes salariés travaille à l’étranger, voire simultanément dans plusieurs pays. Quelles sont les charges sociales dues sur sa rémunération ? Quelles démarches m’incombent ?
Comment déclarer les gains issus d’actions attribuées gratuitement (AGA) ? De stock options (SO) ? De bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) ?
En matière de charges sociales, comment déterminer les taux et plafonds d’assiette applicables aux éléments de rémunération atypiques (sommes versées postérieurement à la rupture du contrat de travail, rappels de salaire, etc.) ?
Nous validons vos modalités de détermination des effectifs de l’entreprise afin d’en tirer toutes conséquences en matière de charges sociales.
La rémunération d’un mandataire social « assimilé salarié » donne-t-elle lieu à un bulletin de paie ? Si oui, avec quelles particularités ?
Frais de santé, prévoyance et assurance de personnes
Les couvertures de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » (protection sociale complémentaire) sont des avantages sociaux complexes. Elles supposent simultanément : de déterminer les obligations pesant sur l’employeur, de respecter une série de conditions cumulatives pour que leur financement puisse profiter d’un traitement social et fiscal de faveur, de comprendre leur articulation avec les régimes de sécurité sociale obligatoires, mais aussi, pour les mettre en œuvre, de souscrire un contrat d’assurance (obéissant à des règles spéciales de droit des assurances).
Nous analysons la conformité des régimes de frais de santé et de prévoyance d’entreprise aux obligations conventionnelles de branche, et évaluons les sanctions et risques afférents aux éventuels écarts constatés.
Afin de faciliter et sécuriser la gestion des dispenses d’adhésion aux régimes de frais de santé, nous préparons des formulaires personnalisés et ergonomiques destinés aux salariés.
Mon comité social et économique (CSE) participe au financement du régime de frais de santé des salariés. Quels sont les points de vigilance à connaître ? Peut-il faire varier sa participation selon les salariés ?
Dans quelles conditions puis-je résilier le contrat d’assurance de frais de santé ou de prévoyance souscrit au profit des salariés de mon entreprise ?
Dans quels cas suis-je contraint de modifier mon accord collectif ou ma décision unilatérale de l’employeur (DUE) instituant mon régime de frais de santé ou de prévoyance ?
Depuis plusieurs années, les cotisations versées au titre du contrat d’assurance de frais de santé ou de prévoyance souscrit dans mon entreprise sont bien supérieures aux prestations versées. Quel est le sort des excédents ainsi générés ? Sont-ils disponibles ? Comment les utiliser ?
Dans quelles conditions un organisme assureur peut-il rendre opposable une augmentation des cotisations ou une modification des garanties au titre du contrat d’assurance de frais de santé ou de prévoyance, notamment en cas de déséquilibre financier ?
La loi « Évin » est-elle applicable aux contrats d’assurance souscrits au profit des fonctionnaires et/ou agents publics (d’État ou territoriaux) ?
Dans quelles conditions un organisme assureur peut-il renoncer à sa qualité d’organisme recommandé pour la gestion d’un régime de frais de santé ou de prévoyance d’une branche professionnelle ?
Dans quels cas des salariés peuvent-ils refuser la couverture de frais de santé en vigueur dans l’entreprise et comment gérer ces demandes de dispense d’adhésion ?
En quoi consiste la création d’un « groupe fermé » de salariés bénéficiaires de couvertures de frais de santé et de prévoyance à la suite d’un transfert de salariés ?
Nous rédigeons ou améliorons les différents documents contractuels de la relation entre l’entreprise et l’organisme assureur (contrat d’assurance, notice d’information, etc.). Notre expérience nous permet de fournir des actes totalement sécurisants pour les parties et évolutifs (anticipant les difficultés pouvant survenir et limitant les besoins de modifications ultérieures). Nous apportons également un soin particulier à la lisibilité et la clarté de ces actes (legal design).
Comment choisir entre les différents modes de mise en place possibles pour les dispositifs de frais de santé et de prévoyance (accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur) ? Quels en sont les avantages et inconvénients et les modalités concrètes ?
Nous proposons aux professionnels de l’assurance de personnes une veille novatrice et ergonomique des textes conventionnels en matière de frais de santé, prévoyance, action sociale, maintien de salaire et retraite, en amont de leur publication sur Légifrance. Elle permet de rester informé le plus rapidement possible, dans chaque branche, de la signature de nouveaux textes, de leur extension ou agrément voire, le cas échéant, de leur agrément par la commission paritaire de l’APEC.
Un fonds social dédié aux salariés d’une seule entreprise peut-il être constitué et alimenté par la provision pour égalisation (PPE) d’un contrat de prévoyance ?
À quelles charges sociales sont soumises les rentes d’invalidité complémentaires ?
À quelles charges sociales et impôts est soumis un capital décès versé dans le cadre d’un régime de prévoyance ?
Quel est le traitement en paie des indemnités journalières complémentaires (IJC) de prévoyance ? En quoi consiste la « règle du prorata » ?
Comment traiter en paie le financement par l’employeur d’un régime de frais de santé bénéficiant aux anciens salariés retraités ?
Peut-on transférer les réserves constituées par les excédents d’un contrat de prévoyance pour compenser les pertes d’un contrat de frais de santé ? Ou inversement ?
Comment modifier, à la hausse comme à la baisse, le financement par l’employeur d’un régime de frais de santé ou de prévoyance ou le niveau des prestations prévues ?
Quelles sont les obligations légales et conventionnelles de mon entreprise en matière de frais de santé et de prévoyance (catégorie de salariés concernés, niveau de prestations, niveau de financement, etc.) ?
En cas de transferts de salariés, qu’advient-il des contrats passés par leur précédente entreprise avec les organismes assureurs ?
Quel est l’environnement social et fiscal d’un fonds social, que ce soient les sommes qui l’alimentent ou les aides qu’il octroie aux bénéficiaires ?
Peut-on déroger à l’obligation patronale dite du « 1,50 % tranche 1 » relative à la prévoyance des cadres par accord d’entreprise ou de branche ?
Dans quels cas dois-je informer ou consulter le comité social et économique (CSE) en matière de frais de santé ou de prévoyance ? Quels sont les risques y afférents ?
Quelles sont les taxes applicables sur un contrat d’assurance de frais de santé ou de prévoyance ? Comment doivent-elles être répercutées sur le tarif de la couverture ?
Un salarié perçoit une rente d’invalidité complémentaire au titre d’un contrat d’assurance de prévoyance. Quelles seraient les conséquences de la résiliation de ce contrat ? Et d’un licenciement ?
Nous formons vos équipes paie et ressources humaines afin qu’elles puissent répondre aux questions de vos collaborateurs et leur expliquer ces situations, mais aussi adopter les bonnes pratiques (sécurisantes vis-à-vis des salariés et des URSSAF).
Nous vérifions si vos régimes de frais de santé et de prévoyance et vos pratiques sont conformes aux règles conditionnant les exonérations sociales et fiscales de son financement.
Qu’est-ce que la notice d’information relative au contrat d’assurance de frais de santé ou de prévoyance ? Comment la remettre aux salariés, sur qui pèse cette obligation et quels sont les risques y afférents ?
Dans un contrat d’assurance, doit-on isoler les cotisations afférentes aux différents risques et appliquer de manière distributive la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) et la taxe de solidarité additionnelle (TSA), selon les différents taux en vigueur ?
Nous rédigeons ou améliorons les actes de mise en place de vos dispositifs (accords ou décisions unilatérales). Notre expérience nous permet de fournir des actes totalement sécurisés (notamment au regard de vos engagements financiers et des conditions d’exonération) et évolutifs (anticipant les difficultés pouvant survenir et limitant les besoins de modifications ultérieures). Nous apportons également un soin particulier à la lisibilité et la clarté de ces actes (legal design).
À la suite du transfert des salariés d’une entreprise à une autre (par exemple en cas de fusion-absorption), les couvertures de frais de santé et de prévoyance continuent-elles à s’appliquer aux salariés transférés ? Selon quelles modalités et pour quelle durée ?
Quelles sont les conséquences, sur la perception de la rente d’invalidité complémentaire, de la suspension de la pension de base en raison de l’atteinte du plafond de revenus (en cas de reprise ou de poursuite d’une activité professionnelle) ?
Un organisme assureur peut-il mettre un terme au maintien gratuit de la couverture frais de santé et prévoyance d’anciens salariés en portabilité ? Quid si l’employeur est placé en liquidation judiciaire ?
Comment changer un indice de revalorisation des prestations de prévoyance selon qu’il soit prévu dans le contrat d’assurance et/ou dans l’acte de mise en place du régime dans l’entreprise ?
À quoi correspond le statut de salarié dit « article 36 » en matière de frais de santé et de prévoyance ?
Comment les indemnités journalières complémentaires de prévoyance (IJC) s’articulent-elles avec les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et avec l’obligation patronale de maintien de salaire ?
À quelles charges sociales et impôts est soumis un capital versé par un assureur en cas d’annonce d’un diagnostic de maladie redoutée ou d’un handicap ?
Nous vous accompagnons dans la formation des collaborateurs de votre entreprise sur tous les sujets de prévoyance et de frais de santé, participant ainsi à l’atteinte des 15 heures de formation annuelle obligatoire dans le cadre de la directive « distribution en assurance » (DDA).
À l’occasion d’un changement d’assureur, quelles sont les obligations pesant sur les deux organismes successifs ? Que ce soit au titre des prestations en cours de service, de leur revalorisation, des rechutes ou aggravations ultérieures liées à un sinistre antérieur ?
Doit-on maintenir le bénéfice des régimes de frais de santé et de prévoyance pendant une suspension du contrat de travail du salarié, telle qu’un congé parental d’éducation ou un congé maladie ?
Le maintien de la complémentaire santé au titre de l’article 4 de la loi « Évin » peut-il s’opérer dans le cadre du contrat d’assurance des salariés actifs ? Pour quel coût ?
Comment modifier ou supprimer le financement par l’employeur d’un régime de frais de santé bénéficiant aux anciens salariés retraités ?
Puis-je conditionner l’accès au régime de frais de santé ou de prévoyance à une ancienneté minimale ?
Dans quelles conditions puis-je moduler le financement par l’employeur d’un régime de frais de santé selon la situation des salariés (famille, etc.) tout en bénéficiant de l’exonération de cotisations de sécurité sociale ?
Quels sont les contours de l’obligation patronale dite du « 1,50 % tranche 1 » relative à la prévoyance des cadres ? Quels en sont les salariés bénéficiaires ? Quelle sanction en cas de violation ?
Quelle est la différence entre la portabilité de la couverture frais de santé prévue par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et le maintien prévu par l’article 4 de la loi « Évin » ?
En cas de transfert de salariés, les bénéficiaires d’un régime de prévoyance doivent-ils à nouveau désigner leurs bénéficiaires en cas de décès ?
La remise d’une décision unilatérale de l’employeur (DUE) par mail est-elle conforme aux règles conditionnant les exonérations de sécurité sociale applicables au financement patronal ?
Rapports
avec les URSSAF
Les URSSAF recouvrent la quasi-totalité des charges sociales dues par les entreprises. Elles vérifient l’application de la réglementation en intervenant auprès des entreprises en amont pour les conseiller dans leur pratique, mais le plus souvent, pour les contrôler a posteriori et, le cas échéant, les redresser en cas de constat d’irrégularités. Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner à chaque étape, amiable ou contentieuse, de vos relations avec les URSSAF, et pour anticiper les difficultés.
Nous vous accompagnons dans la rédaction des demandes de rescrit social auprès des URSSAF pour augmenter les chances de succès.
Si un inspecteur de l’URSSAF considère que des charges sociales sont dues sur un avantage, sur combien d’années peut-il remonter pour réclamer un paiement rétroactif ?
Lorsqu’une entreprise s’aperçoit qu’elle a commis une erreur de charges sociales, peut-elle régulariser spontanément cette erreur ?
À l’issue d’un contrôle par l’URSSAF, une entreprise était redevable d’un montant de 1.374.623 euros de charges sociales et de majorations de retard. Nous avons identifié un vice de forme qui a permis d’annuler le redressement et de faire condamner l’URSSAF à lui rembourser cette somme.
Quels documents les inspecteurs de l’URSSAF peuvent-ils demander à examiner lors d’un contrôle ?
Est-il toujours opportun de soumettre une question délicate aux URSSAF dans le cadre d’un rescrit social, ou cela risque-t-il de me porter préjudice par la suite ?
Comment réagir à la réception d’une mise en demeure d’avoir à payer des charges sociales à l’issue d’un contrôle de l’URSSAF ? Quelles sommes payer et dans quels délais ?
L’application stricte du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) protège-t-il contre tout risque de redressement, même si certaines positions semblent différentes des textes de loi ?
La procédure de contrôle et de redressement de charges sociales par les URSSAF est particulièrement technique et contraignante pour les inspecteurs. Certaines erreurs de formalisme ou de procédure sont de nature à entrainer l’annulation de redressements quand bien même ils seraient justifiés sur le fond. Nous décortiquons la procédure suivie dans votre entreprise et soulevons au bon moment les éventuelles irrégularités.
Une URSSAF peut-elle me reprocher de ne pas appliquer le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), même si certaines positions semblent différentes des textes de loi ?
La contestation des redressements de charges sociales à l’issue des contrôles de l’URSSAF est particulièrement technique. Nous prenons en charge cette procédure afin de garantir le respect des délais impératifs et d’optimiser les chances de succès des recours devant les différentes instances (commission de recours amiable (CRA), pôle social du tribunal judiciaire, etc.).
Un organisme assureur est-il légitime à interroger directement son URSSAF dans le cadre d’un rescrit social afin de sécuriser le traitement social afférent aux couvertures d’assurance qu’il propose, et ainsi éviter tout risque de redressement pour ses entreprises souscriptrices ?
Comment estimer les incidences financières d’un redressement de charges sociales par l’URSSAF à la suite d’un contrôle ?
Y a-t-il une durée au bout de laquelle l’entreprise peut considérer sa pratique comme valable et ne pouvant plus être remise en cause par les URSSAF ?
Saviez-vous que la simple minoration de l’assiette des charges sociales peut être qualifiée par les URSSAF de travail dissimulé ?
L’URSSAF peut-elle changer d’avis entre deux contrôles successifs et remettre en cause une pratique inchangée qui n’avait pas donner lieu à observations ? Et si l’inspecteur n’est pas le même ?
Est-il possible d’être redressé alors même que l’entreprise n’a fait qu’appliquer une position figurant sur le site internet des URSSAF ?
Comment réagir lors de la réception de remarques de l’URSSAF à la suite du dépôt de l’acte instituant un dispositif d’épargne salariale dans l’entreprise ? S’agit-il toujours d’une injonction à se mettre en conformité ? Peut-on contester les remarques formulées ?
Nous vous accompagnons tout au long de la procédure de contrôle URSSAF. Dès la réception de l’avis de contrôle, nous organisons des réunions préparatoires visant notamment à coacher les équipes qui seront les interlocuteurs privilégiés des inspecteurs. Elles permettront de bien comprendre le déroulement du contrôle et de recueillir en amont tous les justificatifs et explications qui devront être fournis. Lors du contrôle proprement dit, nous vous conseillons en backup sur la meilleure façon de répondre aux inspecteurs. Le cas échéant, nous vous accompagnons dans la contestation amiable ou contentieuse du redressement.
Quelles sanctions spécifiques au travail dissimulé peuvent être appliquées par les URSSAF ?
Rémunération
des dirigeants
Le statut de dirigeant peut correspondre à des réalités juridiques différentes. Il peut par exemple s’agir des cadres dirigeants, positions hiérarchiques les plus hautes des salariés de l’entreprise, ou des mandataires sociaux, qui ne sont généralement pas titulaires d’un contrat de travail mais néanmoins assimilés aux salariés en matière de sécurité sociale et de paie. Ce statut obéit à des règles multiples, en particulier concernant leur rémunération et avantages (droit des sociétés, de la sécurité sociale, du travail, etc.).
Quelles procédures doit-on respecter pour attribuer un avantage de rémunération ou de protection sociale à un mandataire social sans contrat de travail ?
Quel est le traitement en paie de la rémunération des dirigeants de sociétés par action simplifiés (SAS) ?
Quels organes de la société sont compétents pour fixer la rémunération d’un mandataire social et/ou l’attribution de tout autre avantage en nature ou en argent ?
Quelles sont les conditions pour cumuler valablement un contrat de travail et un mandat social ? La réponse est-elle différente selon que le cumul intervienne au sein de la même ou de deux entreprises distinctes ? Quelles sont les conséquences en cas d’irrégularité ?
Quelle est l’articulation entre les différentes procédures d’autorisation applicables, dans certaines sociétés, aux éléments de rémunération (« ex-ante » et « ex-post« ) ?
Comment et par qui les conditions de performance parfois impératives pour les mandataires sociaux sont-elles fixées ? Comment et par qui leur atteinte est-elle contrôlée ?
Dans le cadre d’un régime de retraite à prestations définies dit « L. 137-11-2 », quel type de conditions de performance subordonnent l’attribution des droits annuels acquis par les mandataires sociaux ?
Quelles sont les conditions à remplir pour que les dirigeants sans contrat de travail puissent bénéficier des dispositifs de retraite supplémentaire (plans d’épargne retraite (PER), régimes à prestations définies dits « L. 137-11-2 », régimes dits « article 82 ») ?
Les conditions de performance subordonnant l’octroi de certains avantages à des dirigeants doivent-elles être individuelles ou peuvent-elles être appréciées collectivement ?
Qu’est-ce qu’un « carried interest » ?
Le principe d’égalité de traitement s’applique-t-il entre les salariés et les mandataires sociaux d’une entreprise ? Aux mandataires sociaux entre eux ?
À quoi correspond la procédure des conventions règlementées et quand doit-elle être mise en œuvre ?
L’entreprise doit-elle obligatoirement s’assurer que ses mandataires sociaux disposent de la même couverture en matière de protection sociale, notamment de chômage, que s’ils étaient salariés ?
Les dirigeants d’une entreprise constituent-ils une catégorie au profit de laquelle il est possible d’instituer des avantages sociaux spécifiques dans le respect du principe d’égalité de traitement et des règles d’exonération ?
Quelles sont les conditions à remplir pour que les dirigeants sans contrat de travail puissent bénéficier des dispositifs de frais de santé et de prévoyance ?
L’octroi d’un avantage de retraite à un mandataire social d’une société cotée fait-il l’objet d’une procédure d’autorisation particulière ?
Y a-t-il des différences de charges sociales applicables entre la rémunération d’un salarié et celle d’un mandataire social « assimilé salarié » ?
Lorsqu’un mandataire social ne relève pas de France Travail, est-il obligatoire de souscrire à son profit une assurance privée contre la perte d’emploi subie ?
Un mandataire social peut-il prétendre au bénéfice de l’obligation dite du « 1,50% tranche 1 » en matière de prévoyance des cadres ?
Comment savoir si un mandataire social cumulant son mandat avec un contrat de travail peut être affilié à France Travail au titre de l’assurance chômage ? À qui appartient la responsabilité de trancher la question ? Est-il obligatoire d’interroger France Travail ?
La rémunération d’un mandataire social « assimilé salarié » donne-t-elle lieu à un bulletin de paie ? Si oui, avec quelles particularités ?
Quel est le traitement en paie de la rémunération d’un président du conseil de surveillance d’une société anonyme (SA) ?
Les normes collectives de droit du travail instituant des dispositifs de protection sociale complémentaire et d’épargne salariale sont-elles automatiquement applicables aux mandataires sociaux de l’entreprise ?
Que sont les « jetons de présence » rémunérant les administrateurs de sociétés ? Est-ce un mode de rémunération exclusivement réservé aux dirigeants mandataires sociaux ? Quel est leur traitement en paie ?
Quelles sont les conditions à remplir (effectif, spécificités, autorisations de l’organe social compétent, etc.) pour que les dirigeants sans contrat de travail puissent bénéficier des dispositifs de partage de la valeur (participation, intéressement, plan d’épargne d’entreprise (PEE), plan d’épargne retraite (PER) collectif) ?
Rémunérations variables
et réglementées
Les rémunérations variables selon les performances individuelles ou collectives des salariés sont un élement essentiel de certains packages de rémunération. Il convient de sécuriser leurs modalités de mise en place, de modification et de mise en œuvre afin d’éviter tout litige avec les salariés. Par ailleurs, au sein de certaines professions (secteur bancaire et financier ou assurantiel), l’attribution de ces rémunérations est réglementée.
Nous rédigeons ou améliorons les actes de mise en place de vos dispositifs (règlements, clauses de contrat de travail, etc.). Notre expérience nous permet de fournir des actes totalement sécurisés (notamment au regard de vos engagements financiers) et évolutifs (anticipant les difficultés pouvant survenir et limitant les besoins de modifications ultérieures). Nous apportons également un soin particulier à la lisibilité et la clarté de ces actes (legal design).
Quelles contraintes faut-il respecter pour sécuriser la mise en œuvre de rémunérations variables (fixation des objectifs, traitement des absences, langue, etc.) ?
Comment sécuriser l’attribution des rémunérations variables à l’égard du principe d’égalité de traitement ?
Comment fonctionnent les clauses de restitution (clawback) de la rémunération variable en cas d’agissement du salarié contraire à certaines règles professionnelles ?
Qu’est-ce qu’un « carried interest » ?
Comment sécuriser les dispositifs de rémunération à long terme (long term incentives (LTI)) et/ou comportant un mécanisme de rétention, et notamment les conséquences en cas de départ du salarié avant le terme fixé ?
Les rémunérations variables sont-elles prises en compte pour le calcul des diverses indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail ?
Quel mode de mise en place privilégier pour instituer les rémunérations variables (contrat de travail, décision unilatérale de l’employeur, etc.) ?
Comment les rémunérations variables perçues s’articulent-elles avec les obligations patronales de maintien de salaire ?
Quel est l’intérêt des « phantom shares » consistant à attribuer une prime dont le montant définitif varie selon l’évolution de la valorisation de l’entreprise ?
Dans quelle mesure un plan de rémunération variable peut-il être modifié pendant son application (bénéficiaires, montants, objectifs, etc.) ?
Mobilité internationale
L’entreprise doit anticiper et gérer les incidences de l’exercice d’une activité à l’étranger en droit du travail (sort du contrat de travail, du statut collectif, droit applicable à la relation contractuelle, etc.), de la sécurité sociale (charges sociales applicables, niveau de prestations, régime d’affiliation, déclarations préalables, etc.) et fiscal. Le retour en France doit également être soigneusement préparé car il peut être source de réintégration difficile ou de rupture conflictuelle.
Le départ d’un salarié à l’étranger lui fait-il automatiquement perdre le bénéfice d’un régime de retraite à prestations définies dit « L. 137-11 » ? Et s’il a été « fermé » et « gelé » pendant son expatriation ?
Quels sont les différents schémas contractuels susceptibles d’être retenus pour envoyer un salarié à l’étranger (rupture ou suspension du lien contractuel avec l’entité française, conclusion d’un contrat local, maintien obligatoire ou volontaire au régime de sécurité sociale français, etc.) ?
Y a-t-il des déclarations à effectuer, le cas échéant, auprès de quels organismes, lors d’une mission ou d’un déplacement à l’étranger ? Quelle qu’en soit la durée ?
Un salarié licencié à l’étranger peut-il prétendre à l’assurance chômage en France et partant, à la portabilité de ses garanties de prévoyance et de frais de santé ?
Nous formons vos équipes paie et ressources humaines afin qu’elles puissent répondre aux questions de vos collaborateurs et leur expliquer ces situations, mais aussi adopter les bonnes pratiques (sécurisantes vis-à-vis des salariés et des URSSAF).
L’employeur doit-il être assuré pour le rapatriement d’un salarié victime d’un accident pendant un déplacement professionnel à l’étranger ?
Un salarié à l’étranger peut-il prétendre aux bénéfices des dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise française, y compris si les résultats de la filiale étrangère ne sont pas pris en compte dans les paramètres de calcul ?
Un salarié de mon entreprise travaille à l’étranger, dans un seul ou plusieurs pays. Quelles sont les charges sociales dues sur sa rémunération et quels sont ses droits à prestations sociales ? Quelles démarches incombent à l’entreprise ?
Les salariés travaillant à l’étranger sont-ils bénéficiaires des dispositifs de partage de la valeur ? Selon quelles modalités ?
Peut-on continuer à cotiser et à acquérir des points de retraite complémentaire auprès de l’AGIRC-ARRCO pendant une expatriation ?
Une entreprise étrangère sans établissement en France peut-elle employer des salariés exerçant leur activité sur le territoire français ? Quelles sont alors les modalités de déclarations et de paiements des cotisations auprès des URSSAF ?
Les différences d’avantages sociaux liées aux particularités de l’État d’exercice de l’activité sont-elles autorisées et conformes au principe d’égalité de traitement et aux règles d’exonération ?
La réintégration en France d’un salarié ayant travaillé à l’étranger est-elle nécessaire avant la liquidation d’un dispositif de retraite supplémentaire ?
Comment fonctionne l’affiliation à la Caisse des Français à l’étranger (CFE) ? Qui du salarié et/ou de l’employeur est tenu d’y procéder ? Peut-on s’y affilier rétroactivement ?
Quelle est la différence entre le détachement et l’expatriation d’un salarié ? Ces notions sont-elles identiques selon leur utilisation en droit du travail ou en droit de la sécurité sociale ?
Le télétravail depuis un pays étranger doit-il être assimilé à une mobilité internationale et comporte-t-il des conséquences juridiques pour l’entreprise et le salarié ?
Les sommes versées aux salariés travaillant à l’étranger sont-elles soumises à CSG/CRDS ? Et au forfait social ?
Les couvertures de frais de santé et de prévoyance sont-elles les mêmes lorsque le salarié exerce son activité hors de France ?
Quel est le traitement social d’actions attribuées gratuitement (AGA) à des salariés exerçant leur activité à l’étranger ?
Sécurité sociale
Les diverses prestations servies par le régime général ou les régimes spéciaux de sécurité sociale (telles que les pensions d’invalidité, les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) en cas d’arrêt de travail, ou le remboursement des frais de santé) comportent chacune leurs propres problématiques (éligibilité, calcul, conditions de versement et de cumul, etc.).
Quelles particularités s’appliquent au salarié bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique ?
Quelles sont les incidences de l’invalidité sur les droits à retraite ? Dans quelles conditions la retraite d’un salarié en invalidité peut-elle être automatiquement liquidée ?
Comment les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) s’articulent-elles avec l’obligation patronale de maintien de salaire et avec les indemnités journalières complémentaires de prévoyance (IJC) ?
Comment les arrêts de travail et l’invalidité s’articulent-ils avec l’assurance chômage ?
Comment fonctionne l’affiliation à la Caisse des Français à l’étranger (CFE) ? Qui du salarié et/ou de l’employeur est tenu d’y procéder ? Peut-on s’y affilier rétroactivement ?
Quels sont les points de vigilance lorsqu’un salarié est reconnu invalide par la sécurité sociale (conditions permettant de liquider une pension de retraite, cumul avec d’autres revenus, etc.) ?
Y a-t-il des situations dans lesquelles l’entreprise est obligée d’avancer les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) au salarié avant qu’elles soient versées par l’Assurance maladie (subrogation) ?
La reconnaissance d’une invalidité de deuxième ou de troisième catégorie est-elle compatible avec l’exercice d’un emploi ? Et avec certaines situations comme le congé de reclassement ou de mobilité ?
Comment fonctionne le remboursement des frais de santé par l’Assurance maladie ? Qu’est-ce que la base de remboursement ? Qu’est-ce que le ticket modérateur ?
Un de mes salariés travaille à l’étranger, voire simultanément dans plusieurs pays. Quelles sont les charges sociales dues sur sa rémunération et quels sont ses droits à prestations sociales ? Quelles démarches m’incombent ?

Équipe





Distinctions

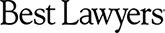



Le fil astella
Le droit des rémunérations et de la protection sociale est une matière en perpétuelle évolution. Que ce soit à l’égard de vos salariés, de vos clients ou de vos prospects, suivre cette actualité est un véritable atout.
Nous avons donc conçu pour vous le « fil astella ». Notre promesse ? Une information réactive, soigneusement sélectionnée, mise en contexte et toujours analysée.
Vous y retrouverez nos commentaires en temps réel, nos articles de doctrine publiés dans les revues spécialisées, des rappels des échéances à venir, nos interventions, ou encore les actualités du cabinet.
Faites défilez le fil ci-dessous intégré à cette page pour voir nos derniers posts, ou bien consultez le en intégralité sur sa page dédiée :
Le fil astella19 février 2026
Partage de la valeur : illustration d’un redressement URSSAF en cas de mauvaise répartition de la participation.
18 février 2026
Plan d’épargne retraite (PER) : près de 7 ans apres la loi « PACTE », les premiers commentaires de l’administration fiscale sont publiés au BOFIP.
19 décembre 2025
Il faut bien avouer que ça nous fait plaisir.
19 février 2026
Partage de la valeur : illustration d’un redressement URSSAF en cas de mauvaise répartition de la participation.
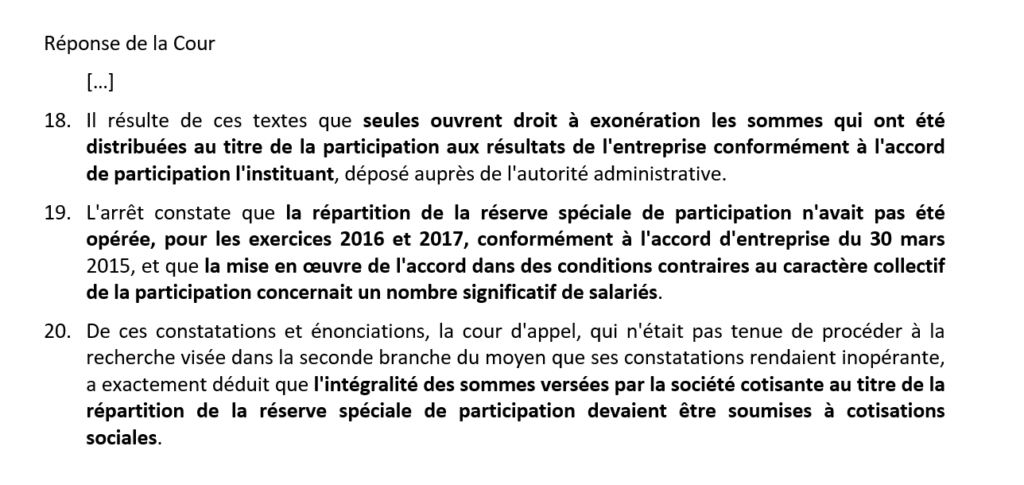
En matière de partage de la valeur et d’épargne salariale, les erreurs dans la mise en œuvre de ces dispositifs sont la principale source de redressement de charges sociales en cas de contrôle par les URSSAF.
En ce sens, la jurisprudence rappelle régulièrement que le traitement social de faveur des sommes versées à ce titre est notamment conditionné à l’application stricte de l’acte qui les institue au sein de l’entreprise (règle qu’on pourrait résumer par « tout l’accord, rien que l’accord »).
Or, la mise en œuvre de ces mécanismes est parfois complexe (et sous-estimée). Si on peut penser que le calcul de l’enveloppe globale à repartir entre les bénéficiaires génèrerait le plus d’erreur, on en rencontre le plus souvent au niveau de l’exclusion illégitime de certains bénéficiaires, ou encore au moment de la répartition de l’enveloppe (qui n’est pas toujours maitrisée).
C’est ce que montre cet arrêt rendu aujourd’hui par la Cour de cassation.
Dans cette affaire, les erreurs commises n’étaient pourtant pas caricaturales :
– 3 personnes sur 900 avaient été exclues à tort du bénéfice de la participation.
– Concernant la répartition, visiblement, les absences pour AT/MP étaient pénalisées si elles duraient moins d’un an (elles n’auraient pas dû l’être du tout). De plus, les indemnités journalières complémentaires (IJC) de prévoyance n’étaient pas considérées comme une rémunération (alors qu’elles auraient dû l’être pour leur part soumise à charges sociales).
Lors d’un contrôle, l’URSSAF a alors soumis aux charges sociales toute l’enveloppe versée par l’employeur, redressement validé par tous les juges du fond puis par la Cour de cassation.
À noter que ce sont surtout les erreurs dans la répartition qui ont scellé le sort de l’entreprise, car, à ce jour, les exclusions pures et simples de salariés peuvent être tolérées si elles concernent un nombre très réduit de salariés.
Il me semble d’ailleurs indispensable d’instituer un dispositif permettant aux employeurs de bonne foi de corriger ce type d’erreur en indemnisant les salariés lésés à la demande des URSSAF, sans courir de risque de redressement.
Quoi qu’il en soit, il est impératif d’être particulièrement vigilant sur ces aspects techniques, qui concernent aussi l’intéressement, l’abondement aux plans d’épargne ou la prime de partage de la valeur (PPV).
18 février 2026
Plan d’épargne retraite (PER) : près de 7 ans apres la loi « PACTE », les premiers commentaires de l’administration fiscale sont publiés au BOFIP.
Cette publication a le mérite de combler un vide : l’absence de commentaires officiels et complets sur la réforme de l’epargne retraite de 2019 etait assez inexplicable.
Son contenu est sans surprise (bonne ou mauvaise). L’environnement fiscal du PER est presenté en stricte application des textes, notamment dans des tableaux récapitulatifs (qui pourraient être plus lisibles).
Pour le reste, cette publication laisse sur sa faim. On n’y trouve par exemple pas de vraie prise de position, alors que les sujets souleves depuis toutes ces annees ne manquent pas.
À sa décharge, il faut dire que le BOFIP n’est pas un guide complet, comme avait pu l’être le guide de l’épargne salariale en son temps…
Ces commentaires sont applicables dès maintenant. Ils sont ouverts à la consultation jusqu’au 17 avril.
19 décembre 2025
Il faut bien avouer que ça nous fait plaisir.
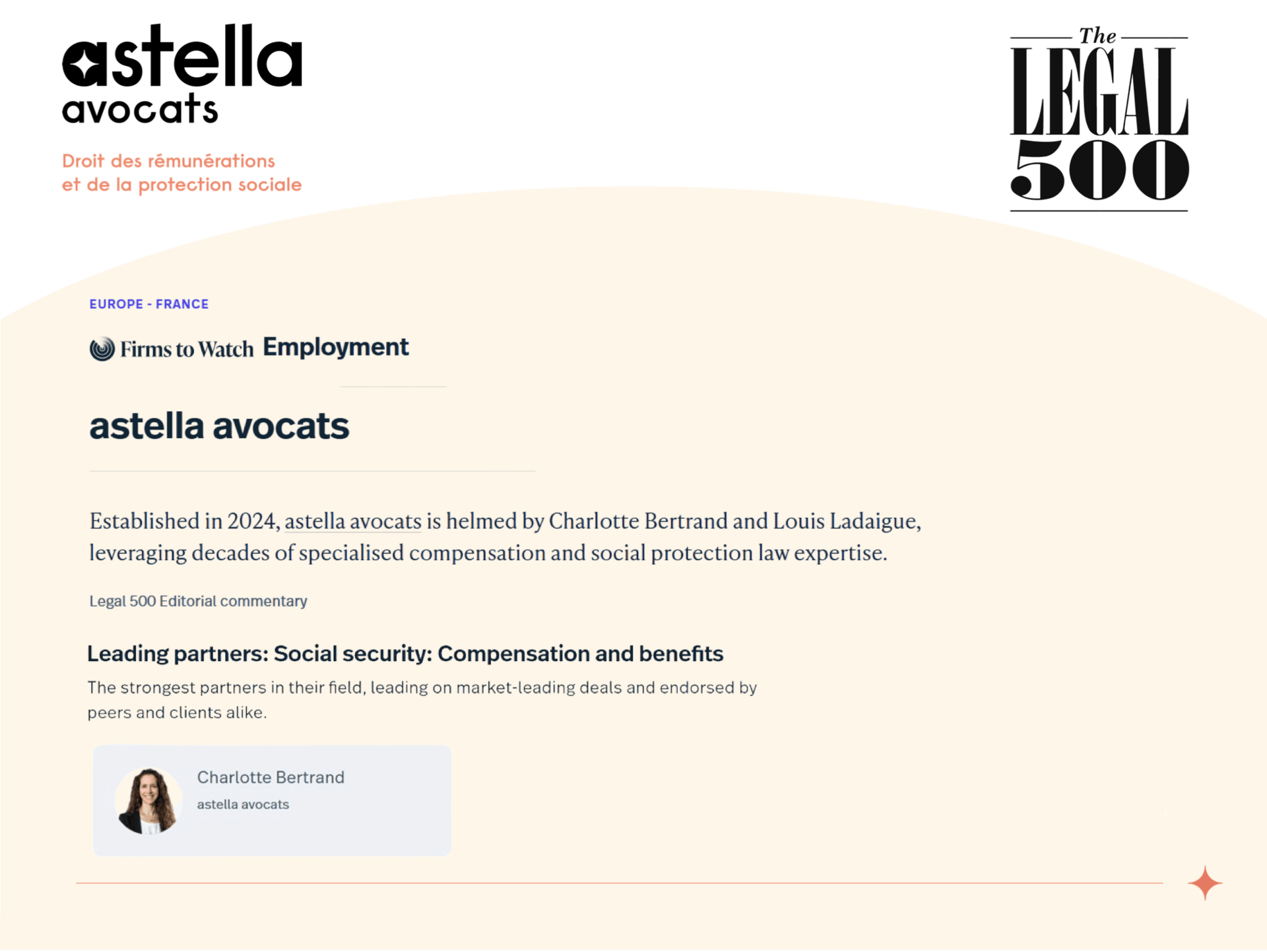
En moins de deux ans, astella avocats s’est installé en haut des classements.
Ces distinctions nous touchent d’autant plus qu’elles récompensent avant tout un travail collectif, exigeant et quotidien.
Un grand merci à notre équipe, à nos clients et à nos partenaires pour leur confiance et leur fidélité. C’est à eux que nous devons cette reconnaissance.
Par ordre de publication en 2025 : Legal 500, Best Lawyers, Best Law Firms et Décideurs.
27 novembre 2025
Prévoyance : la Cour de cassation se prononce sur le sort des réserves en cas de résiliation du contrat d’assurance
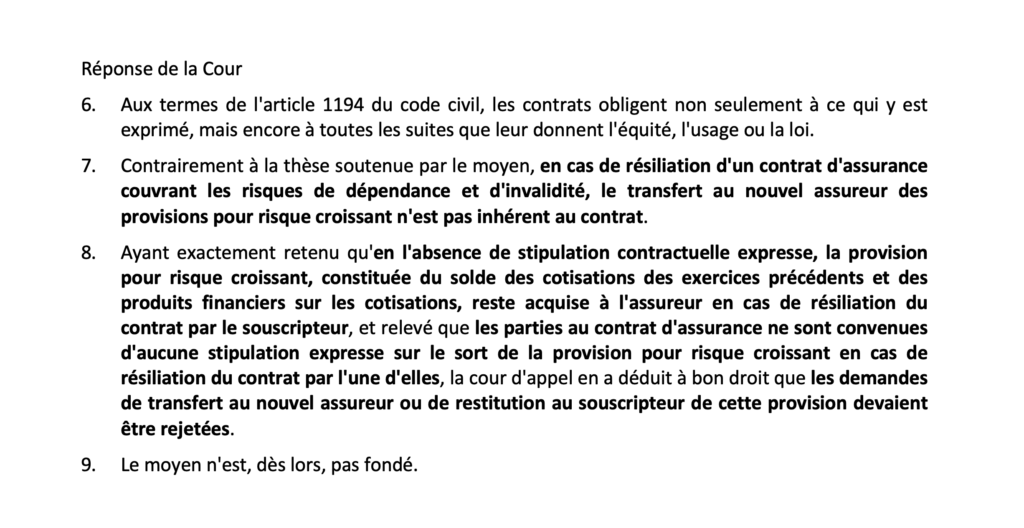
Au cours d’un exercice, lorsque les primes versées au titre d’un contrat d’assurance dépassent le montant des prestations dues, l’opération génère un bénéfice technique.
Se pose régulièrement la question (aux enjeux financiers souvent majeurs) de la propriété de cet excédent. Cette décision y apporte une réponse limpide.
Schématiquement, les parties au contrat peuvent librement organiser la mise en réserve de tout ou partie de ce résultat pour une utilisation ultérieure (dans un document généralement appelé « protocole technique et financier », « clause de participation aux bénéfices » ou « compte de résultat »).
Les parties peuvent par exemple, comme c’était le cas en l’espèce, prévoir la constitution d’une provision permettant de compenser partiellement les augmentations de cotisations futures (ici appelée « provision pour risque croissant »).
Relevant entièrement de la liberté contractuelle, la rédaction et l’analyse des clauses relatives aux réserves est absolument essentielle, comme le rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt rendu aujourd’hui. En effet, la Cour rappelle que, par défaut, ces sommes appartiennent à l’organisme assureur tenant du contrat.
Ainsi, pour pouvoir revendiquer un droit sur ces sommes (par exemple, un droit à les transférer vers un nouvel assureur en cas de résiliation du contrat), le souscripteur du contrat doit obligatoirement pouvoir s’appuyer sur une stipultion contractuelle expresse en ce sens. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.
Au-delà de leur propriété, le sujet du sort des réserves pose bien d’autres questions très techniques mais passionnantes (articulation avec les droits des salariés bénéficiaires voire cofinanceurs du contrat, traitement social et fiscal en cas d’utilisation, etc.).
Lien vers l’arrêt Cass. Civ. 2ème 27 novembre 2025, n° 23-18.857 (FS-B, publié aux lettres de chambre).


